![]()
Documentation:
Katsunori TAKANE- Association nationale des fabricants de matériel de
budô.
http://windows.gr.jp/kendougu/
Katsunori
TAKANE fait partie de la poignée
d'artisans d'art subsistant au Japon. Avec deux autres professionnels, il était
délégué à la maintenance du matériel de l'équipe
du Japon aux derniers championnats du monde. Il est pratiquant de Kendo 6è
dan.
Traduction de Georges Bresset, 09/2002.
Nous abordons dans ces 3 articles, l'observation de pièces du masque de Kendo.
Le nom décrit l'objet: hi.uchi
Connaissez-vous
le mot hi-uchi ?
Anciennement, les épouses de pompiers ou de yakuza (1)
ne manquaient pas de choquer deux pierres entr'elles pour en faire jaillir des
étincelles censées protéger leurs maris partant pour une
intervention. C'est bien de cet hi.uchi dont il est question (2).
C'est ce hi.uchi qui rassure le mari (patron, maître) superstitieux qui
prie pour que rien de facheux ne lui arrive.
C'est le nom donné à deux parties jumelles de l'armure de kendo.
Messieurs les kendoka, ne trouvez-vous pas ceci intéressant ? Il s'agit
d'une résurgence culturelle japonaise.
 |
 |
| hi.uchi installés dans les parties hautes et bases du MEN de monsieur Hiroki MIMAI. | |
Ainsi, dans l'intérieur du MEN, ce sont les pièces qui emboîtent
le menton et le front au-dessus et au-dessous de la face.
Concernant la désignation des diverses pièces, beaucoup sont universellement
utilisées, mais à l'étranger des dénominations très
répandues sont actuellement inventées de toute pièce, négligeant
les termes appropriés, parmi lesquels on trouve "manju"
(3) ou "gyôza" (4) qui n'ont rien à voir
avec leur sens habituel (5).
Insdiscutablement, ces pièces ont la forme du gyôza;
mais est-il vraiment adapté de leur donner ce nom ? De même que
pour manju, le rembourrage de ouate serait la farce de haricots contenue dans
ce gâteau ?
Dans le MEN, ce sont les pièces les plus importantes; elles permetttent
de le verrouiller sur le crâne et la face.
On met le masque en positionnant d'abord le menton; mais on peut aussi disposer
le hi.uchi du front pour ajuster ensuite celui du bas, ce qui demande de forcer.
C'est pour cela que même le matériel ordinaire comporte un renforcement
de cuir au hi.uchi inférieur.
Le MEN de Monsieur MIMAI, lequel a bien réalisé l'importance du
hi.uchi, comporte deux épaisseurs de tissu au menton qui protègent
cette partie très sollicitée, et également un soutien de
cuir, invisible sur la photo (car sur la partie avant) qui lui confère
cette grande résistance.
 |
Déjà
dans ce
MEN de l'an 2 de Ansei (1855) les hi.uchi existent et jouent parfaitement leur rôle |
Le mot hi.uchi
n'apparaît pas seulement dans le milieu professionnel du matériel
Budô. Il est quotidiennement utilisé par ceux qui ont une activité
manuelle que sont les artisans japonais, dans des domaines comme la charpente,
les cloisons mobiles, le marouflage, la confection vestimentaire traditionnelle.
Son sens, sa maniabilité, son importance, font que c'est un mot qui peut
être tout de suite compris. Bâti de bois triangulaire utilisé
pour renforcer la charpente, montage triangulaire à l'intérieur
des cloisons mobiles pour éviter le gauchissement, pointe de tissu de
renfort des basques du haori (surcot) dans le camp militaire, triangle de tissu
de renfort à la base des ouvertures latérales du Hakama: toutes
ces pièces sont des hi.uchi.
Vous qui êtes chargés de la fabrication des matériels chez
les nombreux fabricants, veuillez considérer cet exposé comme
sérieux.
Lecteurs, vous pouvez à présent intégrer et expliquer ce
mot dans votre enseignement.
|
Exemple
de hi.uchi :
|
|
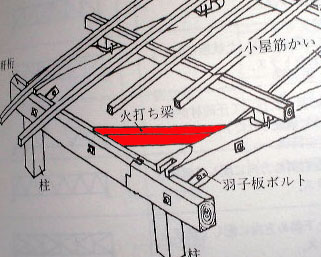 |
 |
|
... Dans le domaine de la charpente,
ce surcot est un haori. |
...
pièce rouge à l'arrière dans
l'intérieur d'un vêtement. |
(1): jadis le yakuza participait à la vie sociale positivement: maintient
de l'ordre (!!!), aide à des travaux de quartier privés ou publics,
etc .
(2): Hi.uchi: littéralement, "feu-coup". Ou l'instrument lui-même
(pierres, briquet, allumette, …)
(3): boulette de pain farcie de haricots sucrés en pâte
(4) sorte de ravioli farci de viande et de légumes, fortement assaisonné
d'ail! (succulent)
(5): leur rapport avec les hi.uchi ne s'établit que par leur forme: gyoza,
"en croissant", manju "en boulette".
Une articulation délicate : le gorgerin (1) (Ago).
"Gorgerin"
: mot explicite qui situe avec concision la fonction et la vertu de cette pièce.
Dans le MEN, ce qui attire en premier lieu le regard est cette zone du menton
qui exige d'être suffisamment solide pour protéger la gorge des
tsuki du shinai.
 |
 |
La pièce de cuir brut qui joint le Men-gane (la grille
du Men) au gorgerin, relie également la naissance des "ailes"
du Men-buton où se forme le point d'embranchement d'où
partent le Men-buton qui protège la tête de l'épaule
(acromion), et la partie de ce même Men-buton qui abrite
le crâne; puis la longueur du gorgerin et celle du Men-buton étant
fonction du gabarit de l'individu, leur ajustement exige une grande solidité
répondant à d'énormes tensions.
Ce point joue le rôle majeur du rivet d'un éventail.
Quant aux cinq
galons sous la partie brodée (Moyo), ils se plient selon une forme concave
au gré de la pratique en accompagnant les mouvements de la face au cours
du Keiko et du Shiai. Ce système d'articulation a pour idée d'éviter
le blocage au contact du Mune (partie supérieure du DO). Sur cette faible
surface est matérialisé le motif qui reflète le goût
du Kendoka qui l'arbore; elle s'assortit au Do-mune. C'est justement
à ces endroits que s'exprime la synthèse du sens artistique de
l'artisan et de savoir faire technique.
Considérez cela comme le mariage de la technique et de l'art.
(1): que nous nommons communément tsuki (du verbe tsuku: piquer, percer)
Le caractère GI (1) de Asagi (2) suggère-t-il la couleur du poireau?
Je crois que c'est
au cours d'une conversation que j'ai eue un jour avec le patron d'un de matériel
budô que ce mot m'est apparu.
Pour tracer le asagi de notre milieu professionnel, nous utilisons
les caractères ASA et GI pour désigner une catégorie de
couleurs dont la teinte du Gi n'est pas jaune pâle mais bleu pâle.
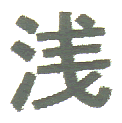 |
Caractère ASA |
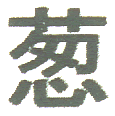 |
Caractère GI |
Le asagi (ici:
jaune pâle) n'est pas une erreur, mais pour ne pas tomber dans le piège,
nous n'utilisons pas ce caractère (jaune) dans la profession.
Je pense que c'est pour faire la différence d'appellation entre l'une
des couleurs de fils bleus pâle du Shokkô (5) qui sert à
broder le gorgerin et le Mune, et la teinte bleu clair également de l'envers
du Kendogi tissés sur deux épaisseurs.
Nous, fabricants de matériel de Kendo avons reconnu pour fondamentale
cette teinte, et l'utilisons pour telle.
 |
La couleur indigo désigne ordinairement un bleu sombre (nuit, marine);
on dit aussi kachi.iro (6) : présage de victoire. Il paraît également
que c'était devenu la couleur préférée des Bushi.
Le dégradé de bleu des fils utilisés, du clair au sombre,
s'établit ainsi: asagi (bleu pâle/clair), Shinbashi-iro (7), nanko
(8), gunsho (bleu outremer), nôkon (bleu foncé/nuit/marine).
Par ailleurs, dans la catégorie des rouges soutenus, des dénominations comme: kodo (limon fin/terre de sienne), kinsa (thé d'or), enji (rouge foncé), cha (dans les temps très anciens utilisé pour rouge et rouge vigne), sont largement utilisées dans la diversité des spécialités du matériel budô (photos: Kendo Nihon revue)
NDT: ce dernier texte est documentaire. D'un intérêt très
limité, je l'ai traduit comme faisant suite au texte sur le gorgerin.
(1): prononcer
Gui
(2): bleu pâle ou jaune pâle selon le second kanji employé
(3): Asa: peu profond, léger, superficiel
(4): poireau
(5): voir article précédent
(6): deux graphies existantes pour tracer Kachi
(7): pont sur la rivière
(8): lecture à confirmer